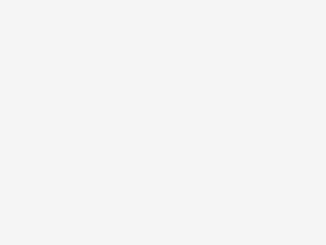Il y a cinquante ans, l’impérialisme US subissait sa défaite finale au Vietnam avec la « chute de Saïgon », le 30 avril 1975. Les US ont dépensé la somme phénoménale de mille milliards de dollars pour tenter de vaincre un mouvement de libération vietnamien majoritairement paysan. En huit ans, 70 % des villages du Nord du Vietnam ont été détruits, au moins deux millions de Vietnamiens ont été tués.
Pourtant, la lutte du peuple vietnamien pour sa libération nationale a fait subir à l’impérialisme US une défaite cuisante et inspiré les luttes anticoloniales dans le monde entier.
D’après Christine Thomas, publié dans Socialism Today, magazine de notre organisation-sœur en Angleterre & Pays de Galles, avril 2025.
L’après-guerre était une période ô combien révolutionnaire dans le monde. L’URSS sous Staline faisait pourtant tout sauf encourager la révolution internationale. Au contraire, défendant ses propres intérêts, elle écrasait tout ce qui pourrait menacer son pouvoir.
Ainsi, au Vietnam, alors que l’occupant japonais, vaincu, quittait le pays en 1945, un soulèvement ouvrier et paysan aboutit à la proclamation de l’indépendance par Hô Chi Minh le 25 août 1945. Cela aurait pu être le tremplin d’une véritable révolution socialiste. Mais suivant les conseils de Staline, il fut déjoué par le Viêt Minh (Ligue pour l’indépendance du Vietnam, créée en 1941 par Hô Chi Minh et le Parti communiste indochinois) et un accord fut conclu avec les puissances impérialistes, qualifiées d’« alliés démocratiques » ! La Chine, au Nord, et la Grande-Bretagne, au Sud, occupèrent le Vietnam, puis le rendirent rapidement à son ancienne puissance coloniale française. L’indépendance n’avait duré que 4 semaines.
Impérialisme vs. révolution sociale
Selon un accord du 6 mars 1946, la France devait progressivement retirer ses 15 000 soldats du Nord, et le Viêt Minh devait mettre fin à la guérilla dans le Sud. Mais après que la France a bombardé Haïphong, au Nord, en octobre, la résistance reprend.
En 1950, l’impérialisme français, affaibli, était clairement en position de défaite, si bien que le Viêt Minh finirait par contrôler le Vietnam. Le soutien des US augmenta jusqu’à financer 80 % de la guerre française en 1954. Finalement, le 20 juillet 1954, les accords de Genève mirent fin à la guerre. Le Vietnam fut divisé : le Viêt Minh au Nord, avec un régime calqué sur l’URSS et la Chine ; et l’impérialisme US dans le Sud capitaliste, avec le gouvernement fantoche de Ngo Dinh Diem à Saïgon.
Sous les attaques accrues de son régime, la résistance reprend. En 1960, Hô Chi Minh lance le Front de libération nationale (FLN) pour unir les forces, surtout paysannes, opposées au régime dans le Sud, et lutter pour la libération et l’unification du Vietnam. Diem réprime brutalement tout opposant présumé, impose un contrôle militaire des villages, provoquant une opposition massive. Il est renversé par un coup d’État militaire en 1963. En 20 mois, 10 gouvernements militaires se succèdent, révélant la faiblesse totale du régime du Sud.
À l’opposé, le programme et les actions du FLN reposaient sur la redistribution aux paysans des terres confisquées aux propriétaires. Cela lui assura une base sociale de masse dans le Sud. En 1962, le FLN comptait environ 300 000 membres et contrôlait trois quarts des campagnes du Sud. Ce n’était pas seulement une guerre militaire, mais une révolution sociale dans les villages.
L’intervention U.S. est un carnage
L’intervention des US débuta avec l’envoi de conseillers militaires au Sud pour entraîner secrètement l’ARVN (Armée de la République du Viêt Nam) sous Eisenhower puis Kennedy, de 1961 à 1963. Désorganisée et corrompue, elle s’avérait incapable de vaincre les forces du FLN. En août 1964, Johnson, successeur de Kennedy, assassiné, lança l’intervention militaire.
En mars 1965, l’opération « Rolling Thunder » déclencha un bombardement effroyable du Nord-Vietnam, le début d’une escalade militaire toujours plus brutale contre le peuple vietnamien. Les 3500 premiers soldats arrivent en mars. Fin 1965, ils sont 200 000. Ils seront plus d’un demi-million début 1968.
Il s’agissait pour les US de garder leur crédibilité à l’échelle mondiale, plus juste de « contenir le communisme ». Des villages entiers sont incendiés, créant des dizaines de milliers de réfugiés. Des milliers de tonnes de napalm (essence gélifiée conçue pour coller aux personnes et aux objets) brûlent les gens vifs. Au moins 20 000 civils sont tués et torturés à mort par l’« Opération Phoenix » de la CIA, visant tout « communiste » présumé.
1968, année charnière

Le 31 janvier 1968, le FLN lance l’offensive du Têt, une attaque simultanée contre une centaine de villes du Sud. Les US durent déployer toute la force de leur puissance militaire pour l’écraser, mais c’était sans compter l’impact psychologique sur la population US. Il était désormais clair pour des millions que la stratégie optimiste qu’on leur avait vendue pendant trois ans (la puissance militaire US allait forcer les Nord-Vietnamiens à capituler, la victoire était imminente…) avait échoué. 40 000 soldats américains avaient déjà été tués dans cette guerre sans fin.
Les Nord-Vietnamiens et les forces de guérilla du Sud étaient prêts à résister à toutes les brutalités. Des brigades de choc, comptant jusqu’à deux millions de personnes, dont de nombreuses jeunes femmes, se mobilisèrent pour réparer routes et autres infrastructures détruites par les bombes américaines.
Les bureaucraties de Chine et d’URSS apportaient au Nord une aide militaire variable, selon leurs intérêts nationaux concurrents. Mais c’est la conscience de masse des ouvriers, des paysans et des pauvres vietnamiens qu’ils menaient une guerre de libération nationale et sociale qui fut vitale pour la résistance vietnamienne.
Aux U.S., la classe dirigeante divisée
L’onde de choc de l’offensive du Têt vivifie le mouvement pacifiste et creuse les divisions de la classe dirigeante. Le secrétaire à la Défense démissionne, le président Johnson, passé de 80 % à 40 % dans les sondages, ne se représente pas. Finalement, Nixon, candidat Républicain de la « paix dans l’honneur » élu de justesse en 1968, annonce en 1969 le retrait progressif des troupes. 10 000 soldats devaient encore mourir entre 1969 et 1973.
À mesure du retrait des troupes et de la « vietnamisation » (le financement par les US des troupes sud-vietnamiennes pour remplacer les soldats américains), les bombardements massifs s’intensifient, censés provoquer une capitulation. En 1970, le Cambodge est massivement bombardé pour couper l’approvisionnement du FLN ; révélé quatre ans plus tard lors du scandale du Watergate, qui força Nixon à démissionner.
Le mouvement anti-guerre et la défaite des U.S.
En 1965, ceux qui manifestaient contre la guerre aux US se comptaient par dizaines. Quatre ans plus tard, le 15 octobre 1969, la plus grande manifestation de l’histoire des US rassemble 15 millions de personnes. Un mois plus tard, ce record est encore battu. 400 universités étaient mobilisées, avec des grèves et des sit-in. Le mouvement fusionnait avec la lutte pour les droits des noirs et les soulèvements des quartiers défavorisés.
La classe dirigeante US n’a plus le choix : un accord de paix est signé le 23 janvier 1973, prévoyant le retrait total des troupes US et le maintien des forces nord-vietnamiennes sur place. Le régime du Sud ne tiendrait pas sans soutien militaire. En avril 1975, les Nord-Vietnamiens entrent à Saïgon.
En Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient, cette victoire sans précédent encourage vivement les luttes pour l’autodétermination et contre des conditions sociales insupportables.
Le Vietnam unifié issu de la guerre n’était pas socialiste. C’était une économie planifiée et bureaucratique, à l’instar d’autres régimes nés de révolutions basées sur la paysannerie ou des sections de l’armée, non pas sur la classe ouvrière organisée : Cambodge, Syrie, Birmanie, Mozambique, etc. Mais l’idée même qu’un système non-capitaliste était possible a affaibli l’impérialisme et le capitalisme dans le monde entier.
La situation mondiale bouleversée
Le spectre de l’humiliation au Vietnam allait longtemps hanter les US. Mais l’effondrement de l’URSS au début des années 1990 amena un ordre mondial totalement nouveau. L’impérialisme US, superpuissance mondiale incontestée, affirmait directement ses intérêts, par la force militaire si nécessaire. Parallèlement, l’idée d’un capitalisme « triomphant », sans alternative possible, fut reprise par la plupart des dirigeants des organisations de la classe ouvrière dans le monde, usant de leurs positions pour abandonner ou freiner la lutte collective des travailleurs.
Aujourd’hui, le monde est instable, multipolaire. La classe ouvrière commence à se libérer de l’héritage négatif de l’effondrement du stalinisme. La lutte de classe collective reprend dans certains pays capitalistes développés, dont les US. Les travailleurs vont devoir construire leurs propres organisations indépendantes pour mener les luttes nécessaires pour changer la société. La mise en place d’un modèle social basé sur une économie contrôlée et planifiée démocratiquement par les travailleurs, avec leur propre gouvernement, inspirera des luttes révolutionnaires partout à travers le monde, contre le capitalisme et pour le socialisme authentique.