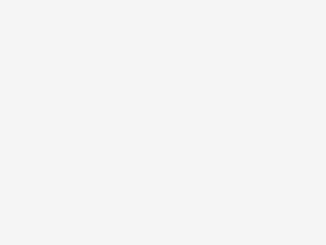Elu le 18 décembre par 54% des voix, le nouveau président de la Bolivie, Evo Morales, a été porté à la tête du pays après un mouvement de masse réclamant la nationalisation des réserves de gaz (les deuxième d’Amérique Latine après le Venezuela) et de pétrole. Ce mouvement de travailleurs pauvres émerge après une décennie de libéralisme économique mené par des gouvernement aux mains des multinationales et de l’administration Bush aux Etats-Unis.
Article paru dans l’Egalité n°120
Juste après son élection, les porte-paroles du mouvement avaient annoncé qu’ils donnaient à Morales 3 mois pour réaliser la nationalisation des exploitations et des réserves de gaz et de pétrole. Faute de quoi les travailleurs retourneraient dans la rue pour faire valoir leurs revendications. Morales se retrouve dans une situation critique où il tente d’une part de calmer la situation explosive du pays en faisant des concessions au travailleurs pour ainsi préserver l’influence de la bourgeoise et d’autre part il est sous la pression de la population laborieuse qui veut voir ses revendications réalisées. Le premier président d’origine indienne apparaît par conséquent comme un intermédiaire entre la bourgeoisie prête à faire des concessions pour sauvegarder ses privilèges et une masse de travailleurs désireux d’améliorer leur conditions de vies, d’avoir part aux richesses du pays et de participer activement à la politique du pays.
En essayant de maintenir la balance entre ses deux lignes politiques, expression de deux classes aux intérêts divergents, Morales a lancé un pari fragile.
Morales allait-il tenir ses engagements ?
Jusqu’au 1er mai 2006, on ne voyait pas clairement quelle voie la Bolivie allait emprunter sous la présidence de Morales. Allait-il tendre vers une continuation et donc un renforcement du libéralisme à l’exemple de Lula au Brésil ou plutôt s’orienter au Venezuela de Chavez qui a été forcé de nationaliser les compagnies de pétrole de ce plus grand producteur de pétrole d’Amérique Latine.
Le 1er mai, Morales décide de nationaliser une partie importante des industries pétrolière et gazière. Des militaires boliviens prennent possession des centres de production gazière et pétrolière en hissant simultanément des banderoles sur lesquelles on peut lire : « nationalisé, appartient aux boliviens ». Les pays voisins comme le Brésil, dont une grande partie de l’approvisionnement en gaz est d’origine bolivienne, sont obligés d’être aussi prudents que Morales face à la détermination de la population bolivienne pour nationaliser ces industries. Cependant, ce geste ne peut cacher l’autre face de la médaille : le gouvernement de Morales est prêt à renégocier les contrats d’exploitation du gaz avec les multinationales et il affirme vouloir travailler avec celle-ci dans des entreprises dont seulement 51% du capital seront entre les mains de l’Etat alors qu’elles étaient jusqu’en 1996 propriété de l’Etat à 100%. Il s’agit donc ici bel et bien d’entreprises de forme de joint-venture entre l’Etat bolivien et les multinationales dont Total.
Concilier capitalisme et revendications du peuple ?
Si Morales n’est pas encore allé au bout de son chemin, la direction qu’il emprunte se dessine facilement. Il ne cherche pas la rupture totale avec les multinationales qui dominent et exploitent à leur guise les richesses du sol bolivarien. Pour lui et son soutien bourgeois, il est donc hors de question de rompre avec le capitalisme.
Morales a été porté par un mouvement de masse qui n’a pas encore créé ses propres représentations démocratiques en dehors des parlements bourgeois, mais il n’est pas le représentant d’un mouvement qui remet en question de manière conséquente et constructive la légitimité de l’Etat bolivien bourgeois. C’est pourquoi Morales ne peut représenter la rupture avec le capitalisme et son Etat bourgeois.
Le mouvement qui l’a amené au pouvoir n’a pas encore développé des organes populaires d’exercice de pouvoirs faisant concurrence à l’Etat bolivien bourgeois sous l’emprise des impérialistes américains et européens. C’est dans ce processus de remise en question du pouvoir de l’Etat bourgeois qui a pourtant été entamé lors des phases de la lutte menant à la démission des prédécesseurs de Morales qu’un parti révolutionnaire a cruellement manqué. L’existence d’un parti révolutionnaire aurait pu mieux structurer et organiser la lutte pour un régime politique au service du peuple.
Pas de marge de manœuvre face à l’impérialisme
Comme l’explique Trotski, dans son ouvrage « la révolution permanente » une véritable indépendance démocratique d’un Etat contrôlé par l’impérialisme ne peut se faire que par la rupture avec le capitalisme. Cette rupture ne peut s’effectuer que si les travailleurs des villes s’allient avec la paysannerie pour renverser la bourgeoisie nationale étroitement liée à l’impérialisme qui est inévitablement international. Luttant contre une bourgeoisie locale dominée par la bourgeoisie impérialiste, cette lutte est par conséquent internationale. C’est ainsi que la lutte pour la nationalisation des industries clés explose le cadre national de la Bolivie et entame les droits d’exploitation économique et de pouvoir politique des pays impérialistes comme les Etats-Unis ou la France.
Les nationalisations partielles en Bolivie ne s’effectuent pas sous la direction de comités de travailleurs, mais bien plus en coopération avec les multinationales et des experts vénézuéliens. Cependant seul un contrôle des travailleurs boliviens de la production signifierait un pas décisif vers l’affranchissement des travailleurs face au capital.
Par Adrien Vodslon