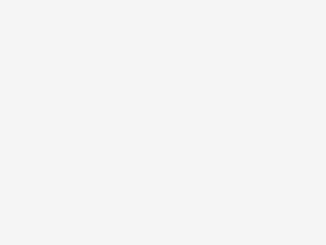Les chiffres sont connus depuis longtemps. Plus de 20% de la population mondiale vit avec moins d’un dollar par jour. 70% de ceux qui vivent dans une pauvreté absolue sont des femmes. Presque un tiers de la population mondiale est sans emploi ou avec un emploi à temps partiel. D’une part le niveau de vie baisse, d’autre part il y a une accumulation gigantesque des richesses entre les mains d’un petit nombre de capitalistes. Les cent dernières années ont vu la production de richesses dépasser celle de toute l’histoire précédente.
Article paru dans l’Egalité n°88
Au 20ème siècle, la population mondiale a quadruplé, la richesse mondiale a été multipliée par dix-sept. Malgré cela le fossé entre riches et pauvres n’a jamais été aussi important. Les 20% les plus riches consomment 86% des biens et des services. Les 225 plus grosses fortunes, surtout présentes aux Etats-Unis, ont autant de richesses que le revenu annuel total des 47% les plus pauvres au monde. Le message est clair : on ne devient riche que lorsqu’on contrôle soi-même les machines, les usines, la force de travail. Celui qui n’a pas de capitaux ne peut pas s’enrichir sur le dos des autres. On ne devient riche qu’en exploitant le travail des autres.
Le mouvement contre la mondialisation démontre que beaucoup de jeunes ont compris le rôle d’institutions comme le Fond monétaire international et la Banque mondiale. Ce sont des instruments puissants aux mains des multinationales et des gouvernements occidentaux. Une politique d’endettement et d’assainissement leur permet de soumettre les soi-disant pays en voie de développement afin de fournir à bon marché des matières premières et du travail aux grandes entreprises occidentales.
Prenons l’exemple de l’Equateur. La politique du FMI dans les années 90 a poussé 62% de la population sous le seuil de pauvreté. Les mesures néo-libérales ont effectivement détruit une partie du pays. Personne ne pouvait accepter une telle politique. La population s’est révoltée avec le soutien des travailleurs des villes. A un certain moment, il y avait même une situation de double pouvoir. Le “parlement populaire”, en l’absence d’une direction socialiste décidée, a laissé glisser le pouvoir de ses mains. Les forces capitalistes ont repris l’initiative et réoccupé le vide politique. En novembre 2000, le FMI s’est de nouveau attaqué à l’Equateur. Il a exigé une augmentation de 80% du prix du gaz, qu’on utilise largement en cuisine, le licenciement de 26.000 travailleurs et la réduction de moitié des salaires de ceux qui restaient. Le gouvernement équatorien a été forcé d’abandonner sa plus grande centrale hydraulique aux multinationales.
Comment les pays sous-développés peuvent-ils aller de l’avant ?
Les jeunes et les travailleurs sont devenus plus sensibles aux inégalités et à la recherche brutale de profit du capitalisme. A la veille d’une nouvelle récession, les conditions de vie minent de plus en plus la propagande bourgeoise. Le débat idéologique est rouvert. Mais quelles mesures, quel type de programme et quelle organisation faut-il aux ex-pays coloniaux pour offrir à leur population un niveau de vie décent ?
Pour répondre à cette question, les marxistes reviennent sur les leçons de la lutte des travailleurs et des paysans lors des révolutions de 1905 et de 1917 en Russie. Au début du 20ème siècle, l’Afrique, l’Asie, la Russie et une grande partie de l’Amérique Latine en étaient réduites à approvisionner à bas prix le marché mondial en matières premières et en force de travail. Les capitaux belges, français, américains et anglais avaient largement investi en Russie. La bourgeoisie nationale, pour autant qu’elle existât, était très dépendante des investissements de l’Occident.
Un élément important dans la structure sociale en Russie, dont le tsar était la figure emblématique, était à ce moment l’existence de la grande propriété foncière quasi-féodale. Les paysans devaient laisser une partie de leur récolte au seigneur féodal. La grande propriété foncière féodale dans les pays néo-coloniaux cède aujourd’hui le plus souvent la place à l’agriculture capitaliste où les petits paysans sont écrasés par la concurrence des grosses multinationales.
Les mouvements actuels contre les dictateurs dans les pays sous-développés, tout comme jadis la Russie féodale, sont confrontés à la même question. Faut-il une phase qui verrait la « bourgeoisie nationale » développer le pays sur les plans économique et politique préalablement à l’introduction de mesures socialistes ?
Léon Trotsky, le plus grand dirigeant avec Lénine de la Révolution russe de 1917, écartait ce scénario d’un revers de la main. La bourgeoisie russe ne pouvait pas développer le pays sans l’argent des capitalistes occidentaux. En outre, elle avait investi dans l’agriculture, tandis que les gros propriétaires fonciers avaient investi dans l’industrie. Le capitaliste russe tendait à soutenir la police tsariste, par peur de la classe ouvrière qui avait acquis très tôt son indépendance. Dans la lutte pour un système parlementaire, elle craignait davantage l’action ouvrière que la réaction tsariste. La bourgeoisie russe craignait par dessus tout l’ébranlement des rapports de production sous toutes ses formes.
Seule la classe ouvrière pouvait donner la terre aux paysans et garantir aux minorités opprimées par le tsar leur droit à l’auto-détermination. La paysannerie était trop divisée entre couches riches et pauvres pour se donner une direction indépendante. C’était une classe qui pensait en termes d’intérêt individuel. Les couches les plus aisées s’identifiaient à la bourgeoisie. Les paysans les plus pauvres suivaient la classe ouvrière. Seule la prise du pouvoir par la classe ouvrière en 1917 a permis de réaliser les tâches démocratiques. Elle ne s’arrêta pas en chemin et est vite passée à des mesures socialistes : nationalisation des entreprises sous contrôle ouvrier et introduction d’une économie démocratiquement planifiée. La révolution acquiert alors un caractère permanent et elle ne peut se maintenir que si elle s’étend aux pays les plus industrialisés dont l’économie permet le développement du socialisme.
L’isolement prolongé de la Russie arriérée économiquement et culturellement a été une des causes de la victoire du stalinisme. Après la deuxième guerre mondiale, l’absence de perspective dans les pays coloniaux et l’existence d’une alternative apparente en Russie ont débouché sur une série de “révolutions permanentes”, fût-ce d’une manière bureaucratiquement déformée. S’appuyant sur une armée de paysans, les leaders staliniens et autres ont oscillé entre les classes pour établir leur propre pouvoir sur le modèle de la Russie stalinienne (Chine, Corée du Nord, Vietnam,…). A Cuba, ce processus s’est déroulé moins consciemment qu’en Chine, mais le pouvoir n’y est pas plus qu’ailleurs entre les mains de comités élus par les travailleurs et les paysans pauvres. Une élite restreinte s’est arrogé tout le pouvoir et ne tolérait à ses côtés aucun parti qui défendait la vraie démocratie ouvrière. La force d’attraction du modèle stalinien s’est fortement réduite dans le courant des années 80 : l’Union soviétique et Cuba sont intervenus auprès du régime sandiniste au Nicaragua pour évite de mener le processus révolutionnaire à son terme, c’est-à-dire vers une transformation complète de l’économie.
En brandissant l’exemple des Tigres asiatiques, la bourgeoisie a essayé de réfuter l’inefficacité globale du capitalisme dans le monde colonial. Une série d’exemples récents démontrent qu’il est impossible, même temporairement, de développer les pays néo-coloniaux sur une base capitaliste.
Le Congo et l’Indonésie
Le dictateur Mobutu a été renversé en 1997 au Congo. Un mouvement de masse dirigé par Kabila a porté un nouveau régime au pouvoir. L’organisation de Kabila, l’AFDL ex-maoïste, avait depuis longtemps laissé tomber la perspective du socialisme. Cela traduisait une tendance générale. Plusieurs mouvements de guérilla en Afrique, en Amérique latine… se sont adaptés au marché dans les années 90. Le renversement du stalinisme les a privés d’une alternative directement utilisable.
Vu le changement du rapport de forces au niveau mondial, Kabila n’était pas prêt à mener la confrontation avec l’impérialisme. Il a zigzagué entre des accords avec les entreprises occidentales et des slogans populistes à l’intention de la population. Un régime répressif et corrompu s’est rapidement développé par manque d’un contrôle démocratique des masses. On a cyniquement alimenté les tensions ethniques. Le capitalisme n’a pas permis de redresser le niveau de vie. Le Congo est resté soumis aux conditions du marché mondial, ce qui signifie aujourd’hui des salaires de misère et la pauvreté.
Ceci ne veut pas dire qu’une réponse socialiste aurait été simple à formuler. D’après nous, Kabila aurait dû donner aux masses laborieuses des villes et des campagnes, ainsi qu’aux petits commerçants, la possibilité de s’organiser dans des syndicats et des comités librement élus. Il aurait dû laisser discuter librement un plan pour la production et la répartition de la nourriture, collectiviser les richesses naturelles et – en cas de boycott impérialiste – chercher des partenaires commerciaux à l’étranger. On a peine à s’imaginer l’impact qu’un tel gouvernement de la population laborieuse et des paysans pauvres aurait eu dans la région. Un appel international pour le socialisme aurait vite mis en branle d’importants mouvements et mis l’impérialisme dans ses petits souliers, dont les velléités d’intervention auraient été contrecarrées.
Limiter d’emblée la lutte à des perspectives bourgeoises vide le mouvement de toute dynamique. Le CIO lutte pour toute ouverture démocratique, mais on ne peut pas séparer artificiellement cela de la lutte des travailleurs et des paysans pauvres pour le socialisme. L’argument qui prétend qu’une population n’est pas prête pour le socialisme n’est qu’une excuse pour les dirigeants qui ne veulent pas faire le pas.
La fin des années 90 a vu la chute de la dictature militaire de Suharto en Indonésie. Des élections ont porté Wahid à la présidence en 1999. Depuis la crise asiatique de 1997-98, l’économie indonésienne se trouve dans une très mauvaise passe. Wahid a beaucoup promis et il hésite maintenant, par peur de la contestation sociale, à ouvrir le pays aux multinationales. Or c’est une condition pour obtenir un prêt du FMI. Les derniers mois ont vu le régime indonésien se déchirer entre la fraction de Wahid et celle de la vice-présidente Megawati, laquelle peut compter sur de nombreux soutiens au sein du vieil état-major de l’armée.
Tout comme dans le mouvement contre la dictature de Suharto, on trouve aujourd’hui des forces de gauche, tel le Parti populaire démocratique, qui prétendent qu’on ne peut lutter que pour un « capitalisme plus démocratique ». Ce parti estime qu’il faut protéger Wahid contre les anciennes forces de la dictature. Mais Wahid est un politicien néo-libéral. Il oscille entre les différents partis, et même entre les classes, pour préserver sa propre position de politicien capitaliste. En outre, il n’hésite pas à envoyer l’armée contre les minorités dont la lutte pour l’indépendance contrecarre les investissements des multinationales comme Exxon-Mobil. Pour préserver le lien avec les minorités opprimées en Indonésie, il faut leur reconnaître le droit à l’autodétermination, tout en en démontrant les limites dans le cadre du capitalisme. L’expérience démontre en Indonésie également que la « démocratie » signifie l’esclavage vis-à-vis du FMI, le bradage aux multinationales, les économies, la pauvreté et les conflits politiques, sociaux et ethniques qui en résultent. Seule la construction d’un parti mondial de la révolution, armé d’un programme socialiste, est en mesure d’offrir aux pays coloniaux une perspective réelle d’aboutir à une autre société. C’est cette ambition, le socialisme mondial, que le CIO veut réaliser dans la période historique qui s’ouvre devant nous.
Par Peter Delsing (MAS/LSP, organisation sœur de la Gauche Révolutionnaire en Belgique)