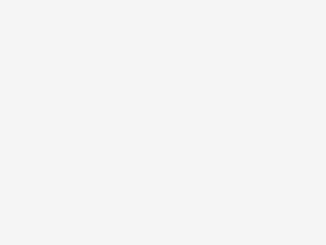La question de la grève générale a été remise à l’ordre du jour avec la lutte commencée le 9 mars, à l’heure où le gouvernement veut nous imposer un recul d’un siècle en arrière avec sa fameuse loi « Travail ». Dans les manifestations, les nombreuses grèves qui ont lieu, dans les syndicats, les AG universitaires ou lycéennes, les Nuit Debout, on se pose cette question. Comment infliger une défaite à ce gouvernement au service des riches et combattre les sales coups du patronat ? De nouveau, l’unité de la jeunesse et des travailleurs à travers leur arme la plus forte, la grève générale, apparaît à juste titre comme une nécessité – pour gagner, ne plus se faire écraser mais aussi refuser de continuer comme maintenant.
La question de la grève générale a été remise à l’ordre du jour avec la lutte commencée le 9 mars, à l’heure où le gouvernement veut nous imposer un recul d’un siècle en arrière avec sa fameuse loi « Travail ». Dans les manifestations, les nombreuses grèves qui ont lieu, dans les syndicats, les AG universitaires ou lycéennes, les Nuit Debout, on se pose cette question. Comment infliger une défaite à ce gouvernement au service des riches et combattre les sales coups du patronat ? De nouveau, l’unité de la jeunesse et des travailleurs à travers leur arme la plus forte, la grève générale, apparaît à juste titre comme une nécessité – pour gagner, ne plus se faire écraser mais aussi refuser de continuer comme maintenant.
Nous publions ici un article écrit en 2010 au moment où la question émergeait encore comme une nécessité en plein cœur de la bataille contre la réforme des retraites et le gouvernement de Sarkozy-Fillon.
A la suite des évènements de ces dernières semaines, avec la multiplication des grèves, des tentatives de grèves reconductibles, la nécessité d’une grève générale apparaissait comme indispensable pour battre le plan de Sarkozy sur les retraites. Cependant, la grève générale mêle beaucoup de questions qui font que cela ne se résume pas uniquement à un moyen d’action mais que cela pose beaucoup de questions politiques, liées aux conditions de la lutte et aux objectifs de celle-ci. La grève générale ne peut se contenter d’être un moyen de remettre les pendules à l’heure, ou de contrer une attaque, car elle pose directement le rejet du fonctionnement de la société toute entière : dans l’histoire, les grèves générales ont immanquablement posé la question, quelle société voulons nous ?
La grève générale, c’est un front uni des travailleurs
Le samedi 12 février 1934, une immense grève générale a eu lieu suite à la tentative de coup d’Etat par les fascistes le 6 février 34. La tentative de coup d’Etat (en fait un assaut de l’Assemblée Nationale) agite toutes les forces réactionnaires dans la société, conduit à la démission du gouvernement Daladier et à la mise en place du gouvernement autoritaire de Doumergue. Durant la semaine, principalement à Paris, les manifestations d’extrême droite et celles organisées par le Parti communiste se multiplient. Dans les quartiers ouvriers des barricades sont érigées. Des milliers d’arrestations, des milliers de blessés et des dizaines de morts, la police tirant désormais sans sommation sur les communistes.
Ce samedi (qui était travaillé à l’époque, la semaine étant de 6 jours), des millions de travailleurs se mirent en grève, et plus de 250 manifestations furent organisée, du jamais vu. A Paris, au cri de «Unité ! Unité !», les manifestants forcèrent les deux principaux syndicats (CGT et CGTU), et les deux principaux partis (SFIO et PCF), à unifier leur cortège. Ils réalisèrent ainsi un front unique des travailleurs. En 1933, en Allemagne, le PS et le PC allemands avaient refusé d’organiser un tel front unique, ce 12 février 1934, leurs homologues français ne le voulaient pas non plus, mais la base l’imposa.
Cette première grève générale va marquer le retour en force des travailleurs dans le paysage politique alors que les effets de la crise de 29, l’existence d’un chômage de masse, les avaient rendu passifs. Les années précédant février 1934 avaient été dominées par les scandales de corruption (affaire Stavisky) impliquant de nombreux politiciens. Le 12 février 1934 conduira aux puissantes grèves de masse de mai-juin 1936. Autant que la menace fasciste, c’est la situation économique et la politique menée par la classe dirigeante qui nourrissait l’envie d’action des travailleurs. Si nous n’avons pas (pour le moment) de véritable menace fasciste, nous avons une crise du capitalisme d’une ampleur jamais vue depuis 1929, et des scandales financiers impliquant largement des politiciens qui nous demandent d’accepter l’austérité.
Les ingrédients fréquents de la grève générale
Ce 12 février 1934, son rôle dans la préparation de la situation de mai-juin 1936 ne sont qu’un exemple. On pourrait prendre également une description de l’année 1967, qui voit se multiplier les grèves, les affrontements avec la police, de grandes journées d’action sans lendemain contre les ordonnances de De Gaulle cassant la sécurité sociale (déjà…). On ne peut pas dire aujourd’hui si la première vague de lutte que nous avons connu en septembre octobre 2010 est réellement une période de préparation, mais une partie des ingrédients est là. La rapidité avec laquelle se sont développés les évènements, la rage profonde contre cette société injuste, cette politique au service des plus riches, cette corruption, et enfin un affrontement avec l’Etat et des coups de forces de la police sur des piquets de grève, accompagné par une riposte encore mal organisée de petits groupes de travailleurs.
Ni en 1936 (grève de masse, occupation d’usines etc.), ni en 1968 (grève générale de 10 millions de travailleurs), la grève ne s’est contentée d’un slogan économique, d’une revendication défensive ou immédiate. D’ailleurs, la tentative en 1906 de la CGT de faire une grève générale sur un mot d’ordre strictement économique (la journée de 8 heures) s’était soldée par un échec.
Une maturation lente de la conscience
Dans la période qui s’étendait du 12 février 1934 à mai-juin 1936, les travailleurs s’organisèrent massivement dans les syndicats et dans les partis. Bien plus qu’une période d’agitation sociale, c’était une période de politisation. L’application du slogan de 1934 «le socialisme ou le fascisme, il faut choisir» se traduisait par le fait de s’organiser et par l’aspiration à l’unité. Le premier élément est cruellement absent aujourd’hui. A cette époque, les directions des deux syndicats et des deux partis tentèrent, vainement, de multiplier les manœuvres pour empêcher le vaste mouvement vers l’unité puis la détournèrent en formant une alliance avec une partie de la Bourgeoisie, sous le nom du «Front Populaire». Là encore, pas de comparaison exagérée, mais le sentiment et la volonté d’unité de ce mouvement de septembre-octobre 2010 a forcé l’intersyndicale à rester ensemble et à appeler à de fréquentes journées d’action mais sans donner d’autres perspectives que celle d’une «autre réforme des retraites», bien en dessous donc de ce que disait de plus en plus de manifestants.
Un des moteurs de la grève générale, c’est donc cet aspiration à la formation d’un front uni des travailleurs, ce qui explique le nombre de référence à l’unité, à la force du nombre et de l’action commune. Mais cette unité est possible s’il y a un objectif commun, car à ce stade, elle n’est qu’un moyen d’action. S’il suffisait de cela, nous aurions vu des grèves générales en 1995 ou en 2003, alors qu’à l’époque la grève n’était générale que dans quelques branches d’activité.
La grève générale, un mouvement politique
En fond de toile de chaque grève générale ou grève de masse, il y a un vaste ras-le-bol qui s’est exprimé plus ou moins clairement. En mai 68, le «10 ans, ça suffit !» (De Gaulle avait pris le pouvoir 10 ans plus tôt) était un des mots d’ordre initial, et par la suite les occupations d’usine disaient directement «l’exploitation capitaliste ça suffit». Une grève générale pose directement, crûment, la question du pouvoir dans une société. Elle est le moyen de poser à l’échelle de toute la société la question de qui gouverne et qui on a envie de voir gouverner.
Cette aspiration a été accompagnée par les directions des partis ouvriers (PS et PCF) en 36 et 68 mais pour être détournées. En 68, le PCF perçu par des millions de travailleurs comme «leur parti», a proposé comme issue à l’immense grève générale, à la paralysie du pays du simple fait de la cessation du travail, une solution institutionnelle : la dissolution de l’Assemblée et des élections législatives anticipées. Alors que la grève générale posait directement la question d’une révolution, d’une prise du pouvoir par les travailleurs eux-mêmes, la direction du PCF, malgré la volonté de nombreux militants de base, a proposé d’en remettre une couche avec le jeu politicien.
Aujourd’hui, la grève générale ne pouvait avoir lieu sur la simple revendication du «retrait de la réforme des retraites» même si c’était par contre le seul moyen d’obtenir ce retrait. Et c’est le lien entre ces deux aspects qui a fait à la fois le caractère massif du mouvement et ses limites. Tout le monde était pour la grève générale reconductible, mais très peu la faisait.
La grève générale pose la question du pouvoir
Dans l’intermède entre 1934 et 1936, le PCF adopta une ligne dite de «défense des revendications immédiates». Une sorte d’écho aux diverses revendications développées par la CGT aujourd’hui et son «emploi, retraite, salaire».
Dans une critique d’une résolution du PCF sur «les revendications immédiates» en mars 1935, Trotsky écrivait :
«Mais même les plus grandes « concessions », dont est capable le capitalisme contemporain, lui-même acculé dans l’impasse, resteront absolument insignifiantes en comparaison avec la misère des masses et la profondeur de la crise sociale. Voilà pourquoi la plus immédiate de toutes les revendications doit être de revendiquer l’expropriation des capitalistes et la nationalisation (socialisation) des moyens de production. Cette revendication est irréalisable sous la domination de la bourgeoisie ? Evidemment. C’est pourquoi il faut conquérir le pouvoir.»
Et plus loin, dans le même texte :
«Les masses comprennent ou sentent que dans les conditions de la crise et du chômage des conflits économiques partiels exigent des sacrifices inouïs, que ne justifieront en aucun cas les résultats obtenus. Les masses attendent et réclament d’autres méthodes, plus efficaces. Messieurs les stratèges, apprenez chez les masses: elles sont guidées par un sûr instinct révolutionnaire.»
Léon Trotsky, «Les revendications immédiates et la lutte pour le pouvoir» (mars 1935)
Ces critiques pourraient s’étendre, de manière plus ou moins appuyée, à de nombreuses organisations même si leur poids rend toute cela moins crucial. Les directions du syndicat Solidaires, du NPA etc. avancent de nombreux mots d’ordre immédiats qui se veulent répondre aux besoins des travailleurs, mais sans les connecter clairement avec la question de qui dirige, qui possède. Dans le mouvement de septembre-octobre 2010, la volonté de «bloquer l’économie» marquait un premier pas et la volonté d’étendre ce blocage par l’entrée en grève d’autres secteurs allait dans le bon sens. Et comme le disaient de nombreux acteurs du mouvement, ce n’est pas seulement la question des retraites qui poussait à cela mais bien un ras le bol de cette politique pour les riches rendue encore plus insupportable depuis le début de la crise.
Mais il manque à une échelle de masse une direction pour que ce ras-le-bol prenne la forme d’un mouvement offensif. Cela passe par la formulation d’un véritable programme pour la grève générale. Les raffineries risquent de fermer une à une ? alors la nationalisation de celles-ci sous le contrôle et la gestion démocratique des travailleurs permettra d’empêcher les plans des capitalistes. Mais comment le faire, quelles organisations mettre en place pour que cela soit possible ? C’est cette question que pose la grève générale et ce de manière directe par les millions de travailleurs qu’elle met en action. Les blocages et les occupations ont pu gêner les capitalistes et le gouvernement, mais ils n’ont pas permis d’aller plus loin par manque de structures permettant d’exercer un réel contrôle.
En apprenant de ces expériences de l’histoire, comment avancer ?
Si nous n’en sommes pas encore à la grève générale, c’est par manque d’alternative à la stratégie de l’intersyndicale, largement dominée par la CGT et la CFDT. Néanmoins, les conditions mûrissent. Le dégoût de la classe de privilégiés que représente les capitalistes et les politiciens, le ras-le-bol des conditions de vie et de travail (et pour les jeunes, d’études qui ne servent souvent à rien), la rage contre l’arrogance et la violence de la clique au pouvoir ne vont pas cesser. C’est cela le puissant moteur de la grève générale, qui fait que si celle-ci est bien le seul moyen de battre une politique, elle ne peut se résumer à cela mais sera l’expression d’une vraie volonté de changer de société, de renverser le capitalisme. C’est à nous de donner un caractère socialiste révolutionnaire à une telle perspective.
En France, dans de nombreux milieux militants, pour de nombreux travailleurs, la grève générale est perçue en référence à la plus grande d’entre elles, mai 68. C’est à dire un mouvement apparemment spontané, et sans réelle direction nationale. En fait, d’autres grèves générales posant les mêmes questions ont eu lieu dans d’autres pays (Grande-Bretagne en 1926, Belgique en 1961 etc.). Elles posaient les mêmes questions politiques de la stratégie et de la prise du pouvoir.
L’absence aujourd’hui d’un parti luttant pour le socialisme et ayant une audience de masse qui proposerait une stratégie alternative oblige de nombreux travailleurs à avancer pas à pas, dans la pratique, en manquant de discussions collectives, la réponse à la question de fond «comment en finir avec tout ça ?». Tant que les travailleurs ne se sentiront pas la force, le niveau d’organisation suffisant… de remettre en cause le pouvoir, les institutions, et d’en créer d’autres à leur place, on passera difficilement d’une situation de grèves et de manifestations massives à une situation de véritable grève générale. 2010 n’est certainement pas 1934 ou 1967, mais dans la période actuelle, une même colère contre le système, contre les privilégiés, contre la répression, est montée d’un cran et s’est exprimée par millions dans la rue. L’urgence de la construction d’un parti qui défende une perspective socialiste révolutionnaire comme débouché à la grève générale en est d’autant plus grande.
Une dernière de Trotsky, pour la route,
«Il est étonnant que le prolétariat supporte passivement de telles privations et de telles violences après une lutte de classes plus que centenaire. » On peut entendre à chaque pas cette phrase si hautaine de la bouche d’un socialiste ou d’un communiste en chambre. La résistance est insuffisante? On met cette faute sur le dos des masses ouvrières. Comme si les partis et les syndicats se trouvaient à l’écart du prolétariat et n’étaient pas ses organes de lutte! C’est précisément parce que le prolétariat, en résultat de l’histoire plus que centenaire de ses luttes, a créé ses organisations politiques et syndicales, qu’il lui est difficile, presque impossible, de mener sans elles et contre elles la lutte contre le capital. Et pourtant, ce qui a été édifié comme le ressort de l’action est devenu un poids mort ou un frein.»
Autrement dit, on ne peut pas laisser la direction du mouvement à ceux qui le freinent.
Article par Alex Rouillard